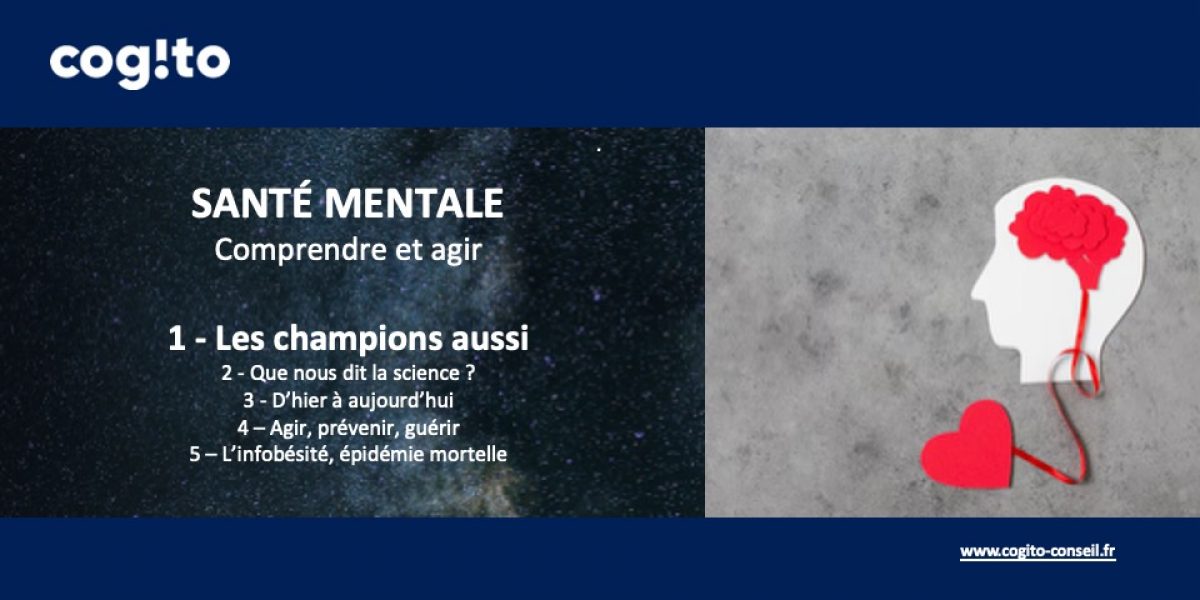L’année 2021 fut une étape importante dans la prise de conscience collective que le sujet de la santé mentale ne concernait pas que « les faibles ». Trois grands champions connus du grand public ont brisé le tabou et cassé le déni dans lequel le monde du sport était enfermé.
Les champions brisent le silence.
Naomi Osaka – Roland-Garros 2021
« On nous demande d’être forts mentalement, mais on ne nous donne pas les outils pour l’être ».
En mai 2021, Naomi Osaka, tenniswoman alors n°2 mondiale et quadruple vainqueure du Grand Chelem, annonce son retrait de Roland-Garros après avoir refusé de participer aux conférences de presse[1], invoquant la protection de sa santé mentale. Elle est initialement sanctionnée d’une amende de 15 000 $ et menacée d’expulsion, avant de se retirer du tournoi.
N. Osaka explique que les conférences de presse aggravent son anxiété et sa dépression, un mal qu’elle cache depuis l’US Open 2018. Elle révèle ne pas avoir eu conscience de l’importance de la santé mentale avant cet épisode, tant le milieu sportif minimise ces enjeux. Sa décision déclenche une dynamique intéressante. Sans surprise, il y a d’abord la polémique : certains médias et instances sportives critiquent son attitude, la qualifiant d’irresponsable. Puis rapidement arrive un soutien massif de la part d’un environnement d’où l’on n’attendait pas une telle réaction : ses sponsors Nike et Mastercard ! De nombreux athlètes prennent la parole dans les grands médias couvrant l’événement et la soutiennent. La polémique s’éteint assez rapidement et le sujet ouvre la réflexion : pourquoi la santé mentale est-elle moins considérée que la santé physique ?
N. Osaka brise le tabou en soulignant l’hypocrisie du système. Elle devient une porte-parole involontaire de la santé mentale dans le sport, inspirant d’autres athlètes à parler ouvertement de leurs difficultés.
Simone Biles – JO de Tokyo 2021
« Je dois protéger mon esprit et mon corps. »
Le 27 juillet 2021, quelques jours donc après N. Osaka sans qu’a priori, il n’y ait de lien, Simone Biles, l’Américaine, gymnaste la plus médaillée de l’histoire (19 titres mondiaux, 4 médailles d’or aux JO de Rio), abandonne la finale par équipes, puis le concours général individuel, malgré les attentes colossales placées sur ses épaules. Elle invoque des problèmes de santé mentale et un phénomène appelé « twisties » (perte de repères spatiaux en l’air, potentiellement mortelle). Les premières réactions sont encore celles du déni avec un discours classique où certains l’accusent de « faiblesse », rappelant le principe du « no pain, no gain » profondément ancré dans le sport. Mais rapidement, sa décision est saluée par la majorité, y compris par des légendes comme Serena Williams. Elle met en lumière la pression extrême subie par les athlètes, surtout les « femmes et les sportifs noirs », précision pas forcément nécessaire avec le recul tellement le sujet s’est élargi, mais précision qui nous indique indirectement que son stress venait s’ajouter à d’autres stress déjà présents depuis longtemps et encore plus profonds. Depuis, S. Biles intègre la thérapie à sa routine et devient une ambassadrice de la santé mentale, encourageant les sportifs à prioriser leur bien-être.
S. Biles brise le mythe de l’athlète « invincible » et montre que la vulnérabilité est une force. Son cas pousse le Comité international olympique (CIO) à renforcer les dispositifs d’accompagnement psychologique pour les athlètes.
Michael Phelps
« J’ai pensé au suicide, la santé mentale est bien plus importante qu’une médaille d’or ».
Il manquait la parole de l’athlète « mâle », l’archétype du héros, imbattable, sans faiblesses, inamovible. Elle arrive avec l’Australien, Michael Phelps, nageur le plus titré de l’histoire (23 médailles d’or) le 22 septembre 2022 à l’occasion du festival « Demain le Sport » à Paris. Il révèle qu’il a dû lutter contre la dépression et des pensées suicidaires après chaque JO (notamment Athènes 2004 et Londres 2012). Il avoue avoir caché sa souffrance par peur d’être perçu comme « faible». Il décrit des « dépressions post-olympiques » liées à la chute d’adrénaline et au vide après les compétitions. Il confirme les mots de N. Osaka, « Si j’avais une blessure physique, on m’aidait tout de suite. Mais pour la santé mentale, personne ne voulait m’aider ».
Aujourd’hui, M. Phelps consacre sa vie à la prévention, via des documentaires (The Weight of Gold) et des conférences. Il salue le courage d’Osaka et Biles, estimant que leur parole a « sauvé des vies ». Il insiste sur l’importance du soutien psychologique dès le plus jeune âge, et sur la nécessité de « normaliser » ces discussions dans le sport. M. Phelps, par son statut et son témoignage « d’homme blanc », impose que le sujet soit traité. Il appelle les fédérations et entreprises à intégrer des programmes de soutien systématique. Ceux qui ne le feront pas ne pourront plus dire qu’ils ignoraient le sujet.
Une dynamique (presque) enclenchée
Le CIO publie une étude en 2022 : 40 % des athlètes olympiques déclarent avoir déjà souffert de problèmes de santé mentale. Depuis, la question traverse d’autres sports où le mythe du héros a encore du mal à accepter la faiblesse de ces champions. Qui n’a pas pensé un jour « au prix où ils sont payés… » ou « avec la vie qu’ils ont, de quoi se plaignent-ils ? ».
Partant du sujet de la santé physique, le rugby où les corps sont de plus en plus malmenés par des chocs incroyables, la parole se libère doucement. En France, c’est un ancien champion et forte personnalité qui en avril 2025 brise le tabou dans ce « sport de gentlemen joué par des voyous ». Sébastien Chabal prend publiquement position sur la question de la santé mentale, et plus particulièrement sur les conséquences des commotions cérébrales. Il révèle souffrir d’amnésie liée à sa carrière de rugbyman, déclarant notamment : « Je n’ai aucun souvenir d’une seule seconde d’un match de rugby que j’ai joué. Je ne me souviens pas d’une seule des 62 Marseillaises que j’ai vécues ». Ces confidences évoquent aussi « un sentiment d’imposture » face à sa notoriété et soulignent « l’écart entre son image publique et sa réalité personnelle ». En rappelant le suicide d’un autre grand champion de ce sport, Christophe Dominici en 2020, ses déclarations ont mis en lumière les enjeux de santé publique liés aux commotions cérébrales et à la prise en charge des anciens sportifs. On est à la frontière entre la santé physique et la santé mentale, mais il apparaît que les deux sujets, aux mécaniques, aux raisons et aux conséquences différentes, ont bien souvent des liens qui ne peuvent être ignorés si l’on veut prévenir et guérir.
Le sujet fait son apparition également en 2025 dans le cyclisme avec d’une part, un vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar , qui ne cache pas son épuisement mental à la fin de l’épreuve, épreuve dont le parcours se fait, chaque année, plus dense pour « créer le spectacle permanent » et dont la vitesse moyenne de course ne fait que s’élever. Je n’ai pas spécifiquement étudié le lien entre fatigue physique et mentale, mais le bon sens nous dit qu’il existe ; d’autre part, la question des morts en course par chute devient un sujet qui ne peut plus être caché. Si dans le passé, ce sport a été entaché de morts plutôt liées au phénomène du dopage (Thompson, Pantani, …) aujourd’hui, les décès, ou accidents très graves, se passent sur la route, dans des descentes vertigineuses ou des sprints massifs. La fréquence semble augmenter :
- Iván Meléndez Luque (Espagne) : chute mortelle en 2025.
- Samuele Privitera (Italie) : chute mortelle au Tour de la Vallée d’Aoste 2025.
- André Drege (Norvège) : chute mortelle lors du Tour d’Autriche 2024.
- Muriel Furrer (Suisse) : chute mortelle aux Championnats du monde juniors 2024.
- Gino Mäder (Suisse) : chute mortelle lors du Tour de Suisse 2023.
- Kota Ikarashi (Japon) : collision mortelle avec une voiture au Tour de Hokkaido 2023.
- Bjorg Lambrecht (Belgique) : chute mortelle au Tour de Pologne.
On meurt aujourd’hui plus sûrement dans les courses de vélo que dans les courses de Formule 1. On ne peut pas accepter aujourd’hui que les gladiateurs cathodiques finissent dans le sang comme ceux du Colisée. Les instances comme l’UCI (Union Cycliste Internationale) commencent à réfléchir aux différents moyens de stopper cette dérive.
Mais la prise de conscience n’est pas encore générale. L’ancien monde existe toujours. La course frénétique de la FIFA, présidée par Gianni Infantino, qui crée toujours plus de compétitions (pour toujours plus de pouvoirs et d’argent) porte en elle la genèse d’une future crise. Toutes les idées de « ligues privées » type NBA que l’on voit apparaître en germe dans le foot, le basket, le handball semblent déjà d’un autre temps au regard du problème de santé physique et mentale dans le sport. Une équipe de basket de niveau européen va jouer 90 matchs en neuf mois, soit 10 matchs par mois, soit 2 à 3 par semaine et ceci en déplacement permanent de Lisbonne à Riga et d’Istanbul à Paris, sans parler des matchs des équipes nationales… Cela devient une folie.
Conclusion
Si j’ai commencé cet article par l’exemple des sportifs, c’est que pour avoir travaillé à une époque avec l’entraîneur d’une grande équipe de basket, j’avais appris que l’effet d’une décision (ou d’une erreur) sur le fonctionnement d’une équipe était très rapide, on voyait dès le match suivant les conséquences de ses choix, là où dans l’entreprise, il faut quelques fois des mois ou des années pour s’en rendre compte. Depuis, l’observation du management dans le sport a toujours alimenté mes réflexions. Naomi Osaka, Simone Biles et Michael Phelps ont permis une prise de conscience dans le monde du sport dont nous devons nous saisir aussi dans l’entreprise. Leur parole a déstigmatisé la vulnérabilité au travail et accéléré la mise en place de dispositifs de prévention.
Les sportifs de haut niveau peuvent être des héros et des modèles, mais à l’exception de quelques extra-terrestres, ils restent pour la majorité des humains comme tout le monde, de jeunes humains qui ont juste la caractéristique de faire un métier qui est un sport. Face à une sur-sollicitation continue, intense, répétée, leurs corps comme leurs mentals, même bien entraînés et aidés, ont des limites.
La prise de conscience collective sur la santé mentale dans le sport a permis d’ouvrir le regard et les esprits pour illustrer leur impact sur la société et le monde professionnel. Un dirigeant ou un manager ne sont-ils pas censés répondre en permanence à l’image du boss toujours en forme, jamais fatigué et surtout jamais « faible » ?
Le physique et le mental d’un salarié, d’un cadre, d’un dirigeant placé dans le même type de situation, n’ont pas de raison de mieux réagir, de mieux résister, d’être plus forts. Ce que nous apprennent ces champions, associé à ce que la science nous a déjà appris que nous allons voir dans le chapitre suivant, doivent nous inspirer pour une meilleure gestion de nos ressources humaines dans nos entreprises, top managers et dirigeants compris.
Nous verrons dans les articles à suivre ce que nous dit la science ; nous essaierons ensuite de comprendre pourquoi ce problème n’existait pas il y a 50 ou 100 ans ; nous verrons alors comment agir au sein de l’entreprise pour prévenir ce mal nouveau ; enfin, dans le dernier article, nous verrons comment survivre et se protéger contre le tsunami de l’information et en particulier, la tyrannie des emails.
Michel MATHIEU
Le 17 octobre 2025
[1] Après chaque match, les joueurs sont dans l’obligation, sous peine d’amendes, de satisfaire aux appétits médiatiques d’une « meute » de journalistes qui posent toujours les mêmes questions à la recherche évidentes de la faille, du scoop ou pire, du buzz.