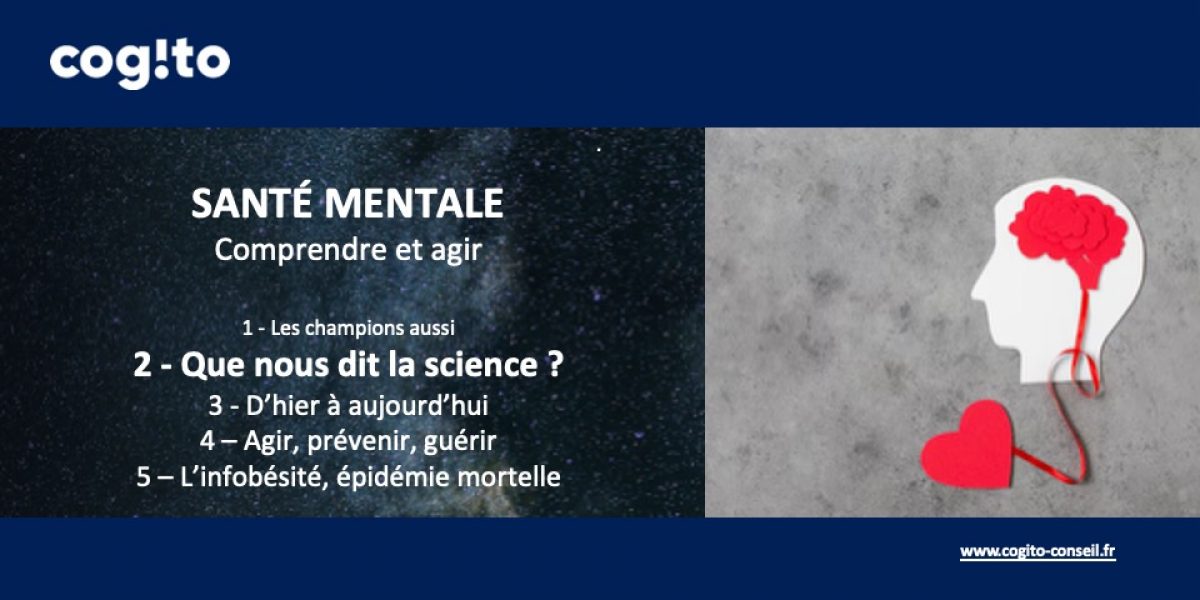Herbert Freudenberger et Chritina Maslash
Les premiers travaux sur le sujet date de 1974 et sont l’œuvre d’un psychologue et psychothérapeute américain d’origine allemande, Herbert Freudenberger (1926 – 1999). Il a été le premier à décrire le syndrome d’épuisement professionnel, ou “burn-out”. Dans son premier texte académique[1], Freudenberger décrit le burn-out chez les professionnels de santé, à partir d’observations dans une clinique new-yorkaise. Son livre « Burn-out : the high cost of high achievement » a été publié en 1980 et traduit en français en 1987 sous le titre « L’épuisement professionnel : la brûlure interne ». Ce livre est considéré comme la référence fondatrice sur le burn-out et a inspiré des décennies de recherches en psychologie du travail. Il y introduit l’idée que l’épuisement professionnel est lié à un déséquilibre entre les ressources individuelles et les exigences du travail. Il a contribué à la reconnaissance du burn-out comme un enjeu de santé publique, bien avant son intégration dans la classification internationale des maladies de l’OMS en 2019.
Il définit le burn-out comme « Un état d’épuisement émotionnel, physique et mental causé par un investissement prolongé dans des situations exigeantes sur le plan émotionnel. ». Il décrit 12 phases[2] du burn-out, allant de l’excès d’ambition à l’épuisement total.
Freudenberger a également publié de nombreux articles dans des revues spécialisées en psychologie et en santé mentale, notamment sur :
- Les mécanismes du stress chronique et ses conséquences sur la santé.
- La prévention du burn-out dans les professions à haut risque.
- L’impact des dynamiques organisationnelles comme le management toxique ou le manque de reconnaissance.
Avec la montée des risques psychosociaux (télétravail, hyperconnectivité, pression des résultats), les analyses de Freudenberger sont plus que jamais d’actualité. Ses recommandations (équilibre vie pro/vie perso, reconnaissance au travail, soutien social) sont au cœur des politiques RH modernes. Ses travaux ont inspiré des politiques de prévention dans les entreprises et les institutions de santé, ainsi que des lois (comme l’obligation de prévention des risques psychosociaux en France). Ses travaux offrent des clés pour repérer les signes avant-coureurs et agir en amont, avant l’épuisement, nous les verrons dans la dernière partie de cet article.
Freudenberger a influencé des générations de chercheurs, dont Christina Maslach (1946 – …), psychologue sociale et professeure à l’Université de Californie (Berkeley). Elle a complété les travaux de Freudenberger et étudiant le burn-out sous un angle différent abordant les aspects organisationnel et social : « Un syndrome psychologique en réponse à des stresseurs chroniques au travail, caractérisé par trois dimensions : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation (cynisme) et la réduction de l’accomplissement personnel. »
Son apport est intéressant pour les dirigeants et managers qui cherchent à comprendre les racines du burn-out et à mettre en place des stratégies de prévention adaptées. Elle développe le Maslach Burnout Inventory (MBI)[3], un outil de mesure toujours utilisé aujourd’hui pour évaluer le burn-out dans les entreprises.
Ces deux chercheurs partagent trois points essentiels :
- La reconnaissance du burn-out comme syndrome : ils s’accordent sur le fait que le burn-out est un phénomène distinct de la dépression ou du stress aigu, lié spécifiquement au travail.
- L’importance de la prévention : tous deux soulignent la nécessité d’agir en amont, avant que l’épuisement ne devienne irréversible.
- Le rôle du soutien social : Freudenberger et Maslach insistent sur l’importance du soutien des collègues et des supérieurs pour prévenir le burn-out.
De son côté, Freudenberger répond à la question : « Pourquoi certains individus craquent-ils ? ». Il met l’accent sur la personnalité et les comportements individuels (surinvestissement, perfectionnisme) ce qui amène à mieux cibler les actions à mettre en place (formation à la gestion du stress, accompagnement psychologique).
Quant à Maslach, elle répond à la question : « Pourquoi certaines organisations génèrent-elles du burn-out ? ». Elle aborde donc le burn-out comme le résultat de dysfonctionnements organisationnels (surcharge, manque d’autonomie, injustice) ce qui amène à mieux cibler d’autres type d’actions à mettre en place (réduction de la charge de travail, amélioration de la reconnaissance).
Ses deux approches sont complémentaires et permettent aux managers de mieux encadrer le sujet, l’individu d’une part, l’organisation d’autre part. Il est donc important pour un manager ou dirigeant de combiner des deux approches.
Au-delà du burn-out
Plus récemment, d’autres définitions ont été posées qui permettent d’être plus précis dans les échanges, les réflexions et les actions :
- Santé mentale : état de bien-être permettant à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et de travailler de manière productive. (OMS en 2001)
- Stress professionnel : déséquilibre entre les exigences du travail et les ressources pour y faire face, entraînant une tension physique et psychologique.
- Risques psychosociaux (RPS) : risques pour la santé mentale liés à l’organisation du travail, aux relations professionnelles et au contenu des tâches. (accord national interprofessionnel sur le stress, 2008, France)
Le burn-out a été reconnu officiellement par l’OMS (2019) comme « phénomène lié au travail ». En France, il est reconnu dans le Code du travail depuis 2021 impliquant une obligation de prévention par l’employeur. Pour l’OMS ou dans le droit français, ce n’est pas (encore) « une maladie professionnelle ».
D’autres concepts voisins sont apparus récemment comme le bore-out : syndrome d’épuisement professionnel lié à l’ennui, au manque de travail ou à des tâches sans sens (Peter Werder et Philippe Rothlin, 2007). Là où le burn-out résulte d’un excès de travail ou de pression, le bore-out est issu d’un manque de stimulation ou de charge. Les symptômes sont le désengagement, la perte de motivation, le sentiment d’inutilité, voire la dépression. Il peut concerner les salariés en sous-activité chronique (restructuration, bullshit jobs, …) ou ceux victimes du taylorisme moderne très présent, en particulier dans les grands groupes déshumanisés, où le tableau de bord sert de manager, où la digitalisation des process a fragmenté les tâches et où la responsabilité est rendue à l’algorithme. La mécanique est redoutablement efficace mais infernale pour le travailleur moderne, lui empêchant toute capacité de compréhension de son rôle et de la finalité de son action.
On entend également parler de :
- Brown-out : perte de sens au travail, souvent liée à des missions floues ou contradictoires (André Spicer, 2017).
- Présentéisme : le fait d’être physiquement présent au travail, mais mentalement absent, avec une productivité réduite (coût estimé à plusieurs milliards d’euros par an en Europe).
Ces définitions sont utiles pour les managers :
- Pour éviter les confusions : ne pas tout regrouper sous le terme « stress ».
- Pour adapter les solutions : un salarié en bore-out n’a pas les mêmes besoins qu’un salarié en burn-out.
- Pour anticiper les risques : identifier les signes précoces pour agir en prévention.
La mécanique du stress
Le stress est une réaction naturelle du corps face à une situation perçue comme menaçante ou exigeante. Il active des mécanismes physiologiques, en particulier la sécrétion de deux hormones : l’adrénaline et le cortisol, qui déclenche le mécanisme dont l’organisme a besoin pour faire face à ce stress : combattre ou fuir. Les sources de stress sont variées et dépendent de chaque individu. On identifie plusieurs grandes sources de stress :
- Stress environnemental : bruit, pollution, surpopulation.
- Stress professionnel : surcharge de travail, pression hiérarchique, précarité.
- Stress personnel : problèmes familiaux, financiers, deuil, divorce.
- Stress sociétal : attentes sociales, réseaux sociaux, actualité anxiogène.
- Stress physiologique : manque de sommeil, mauvaise alimentation, maladie.
À court terme, le stress peut être bénéfique, car il stimule la concentration et la réactivité, mais s’il devient chronique, l’organisme se sature d’adrénaline, l’organisme devient accro, inconsciemment, la personne sera poussée à aller générer de l’adrénaline, ou une compensation, plutôt que de chercher les solutions pour en diminuer la production. L’organisme finit par ne plus savoir plus comment en gérer les excès. C’est là que les problèmes de santé commencent. Le stress prolongé impacte plusieurs dimensions de la santé :
- Physique : maux de tête, troubles digestifs, fatigue, hypertension, affaiblissement du système immunitaire.
- Émotionnel : anxiété, irritabilité, dépression, sentiment d’être débordé.
- Comportemental : troubles du sommeil, addictions (tabac, alcool), isolement social.
- Cognitif : difficultés de concentration, troubles de la mémoire, prise de décision altérée.
C’est là que le meilleur des champions qui, depuis vingt ans est au top, sombre dans l’alcool ou la drogue s’il n’est pas préparé à sa fin de carrière. À la chute brutale de son adrénaline quotidienne, son organisme va chercher une solution qui satisfera un nouveau « plaisir ».
Le bien-être
Il est utile de définir cette notion de « bien-être » dans le cadre de ce travail sur la santé mentale car, comme j’aime souvent à rappeler ce que disait Albert Camus : « Mal nommer les choses ajoute aux malheurs du monde ». Cette notion de « bien-être » évoque dans le langage courant une idée du genre « la plage, les cocotiers, le soleil, le rhum et le farniente ». C’est une erreur.
La notion de « bien-être au travail » désigne un état global de satisfaction, d’épanouissement et de santé physique et mentale des salariés dans leur environnement professionnel.
C’est en partant de cette erreur qu’il y a une dizaine d’années, sans travail sérieux sur le sujet, pour répondre à une pseudo-demande d’une génération biberonnée au « bien-être », de nombreuses entreprises, principalement des grands groupes, se sont débarrassées du sujet en nommant un happyness manager et en installant un baby-foot à côté de la machine à café. Non, la santé au travail ne dépend pas d’un happyness manager ! Elle dépend, pour son côté systémique, des choix de l’entreprise en termes d’organisation (voir plus loin) et, pour son côté quotidien et pragmatique, de la compétence des managers, donc de leur sensibilisation au sujet et de leur formation.
Conclusion
Le burn-out est né dans les années 1970 aux États-Unis, dans un contexte de transformation des modes de travail (intensification, précarisation). En Europe, sa reconnaissance a été plus progressive, avec des différences culturelles : les pays nordiques l’ont intégré plus tôt dans leurs politiques de santé au travail que la France. Le chemin a été long, mais aujourd’hui, la prise de conscience est là, il ne fait plus de doute que ce n’est pas une question de « faiblesse » mais un sujet à prendre en compte pour le bénéfice de tous.
Il reste à comprendre pourquoi ce sujet n’existait pas il y a 50 ou 100 ans alors que les conditions de travail étaient intrinsèquement plus difficiles. C’est l’objet du chapitre suivant. Nous pourrons ensuite étudier les solutions à mettre en place pour prévenir, et si nécessaire, pour guérir.
Michel MATHIEU
Le 17 octobre 2025
Dans le premier article, nous avons vu comment de grands champions ont su briser le silence qui existait sur ce sujet de la santé mentale. Nous expliquerons dans l’article à suivre pourquoi ce problème n’existait pas il y a 50 ou 100 ans ; nous verrons ensuite comment agir au sein de l’entreprise pour prévenir ce mal nouveau ; enfin, dans le dernier article, nous verrons comment survivre et se protéger contre le tsunami de l’information et en particulier, la tyrannie des emails.
[1] “The Staff Burnout Syndrome in the Health Professions” (article, 1974).
[2] Voir le détail en annexe de l’article complet et dans la dernière partie pour les mises en pratiques.
[3] Voir dans la partie 4 pour les mises en pratiques.