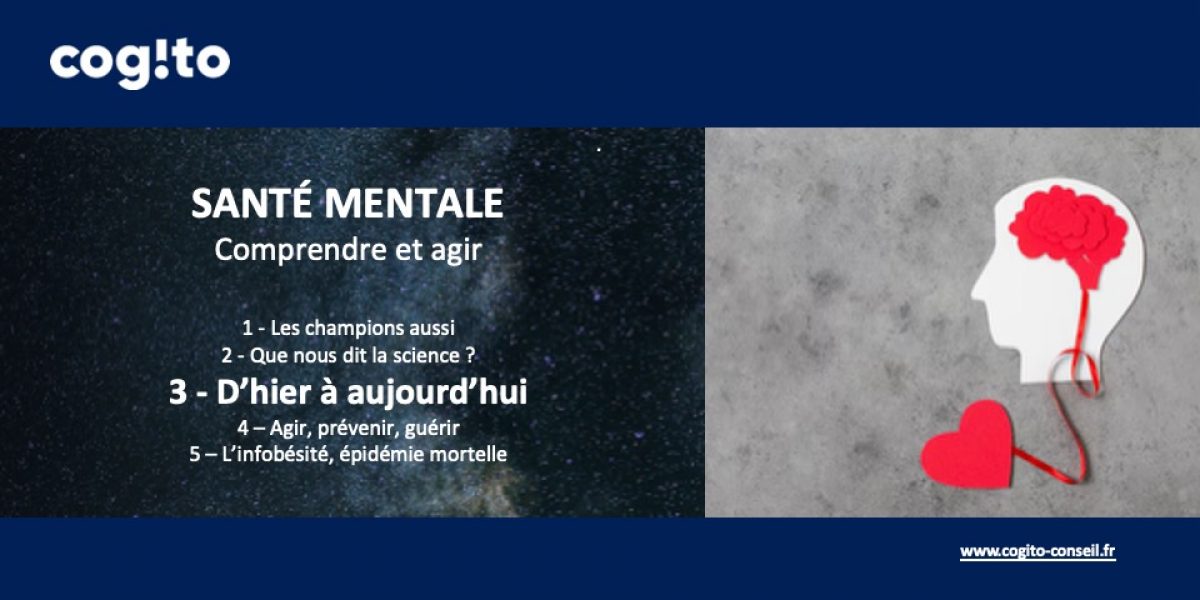La nature du travail a radicalement changé.
Il y a 100-150 ans, le travail était principalement physique. On allait à l’usine, dans les champs, à la mine. Les risques étaient immédiats et visibles dans des accidents majeurs comme les coups de grisou et les conditions de travail dures soudaient les hommes et les familles. Les injonctions sociales de la société comme celles du monde du travail étaient simples : produire, survivre et nourrir sa famille, les besoins des individus se situaient sur le bas de la pyramide de Maslow. Quand il y avait souffrance, elle était collective. Nos anciens étaient encore loin de la « quête de sens » et quand il y avait des questions, les réponses arrivaient par la religion, la guerre et les révoltes qui, dit en passant, étaient plus fréquentes et plus dures qu’aujourd’hui, la révolte des Canuts à Lyon en 1831 en est un parfait exemple.
On ne parlait pas de « bien-être » et la santé mentale n’était pas un concept identifié. On parlait de « fatigue », de « mélancolie », mais pas de burn-out, de dépression ou d’anxiété professionnelle.
Aujourd’hui, la composante physique du travail s’est beaucoup réduite et les composantes cognitives, relationnelles et émotionnelles sont apparues et prennent de plus en plus de place. Au sein des entreprises, conséquence du cheminement de l’économie depuis 1945, de la mondialisation et de l’intensification de la concurrence, la pression du résultat est partout et à tous les niveaux. Depuis vingt ans, l’ère numérique apporte autant de simplification que de complexité pour laquelle personne n’est vraiment formé. Beaucoup de managers et de dirigeants se noient dans la sur-sollicitation numérique (emails, notifications en tout genre, réunions et infobésité).
L’exigence de performance est devenue plus individuelle que collective, chacun est jugé sur sa productivité, sa créativité, sa capacité à s’adapter en permanence. En parallèle, le télétravail et la digitalisation ont réduit les interactions sociales authentiques, augmentant le sentiment de solitude. Pour les cadres, la frontière vie pro/vie perso s’est effacée.
Au niveau de l’encadrement intermédiaire, cadre ou non-cadre, il faut apprendre à jouer avec les fameuses injonctions contradictoires : faire plus avec moins ; être le green, mais moins cher ; investir tout en ayant un résultat à court terme ; etc … L’informatisation, puis la digitalisation, ont remis en place un taylorisme qui ne dit pas son nom : les tâches sont fragmentées et pilotées par des systèmes (techniques et humains) lointains. L’Excellisation à outrance empêche la hauteur de regard qui permettrait de mieux comprendre le pourquoi des tâches. Un virus nouveau est né : le Mesurid. Quand il se combine à l’infobésité, il attaque les neurones et les conditions sont réunies pour un syndrome de santé mentale.
Ces différentes bascules ont comme résultat une souffrance moins visible ; il n’y a pas de blessures physiques, mais des conséquences plus insidieuses et individualisées, plus difficilement verbalisables et peu acceptées jusqu’à une période récente.
L’évolution des attentes sociétales et individuelles
Il est aujourd’hui plus facile de parler de dépression, d’anxiété, de burn-out. Nous assistons à une dé-stigmatisation des troubles psychologiques dont les décisions et prises de position de N. Osaka, S. Biles et M. Phelps ne sont que des illustrations. Des campagnes comme la « grande cause nationale » décrétée par M. Barnier participent au mouvement, même si dans ce cas particulier, nous n’avons pas vu grand-chose à part un effet d’annonce. Les « semaines de la santé mentale » lancées par l’OMS et organisées en France du 6 au 19 octobre 2025 sont passées sous les radars des grands médias certainement très occupés par l’actualité politique de cette période (chute des 1ers ministres Bayrou et Lecornu 1). Même sur le réseau LinkedIn, le sujet est peu présent.
Hier, le travail était d’abord une nécessité de survie. La reconnaissance sociale passait par l’effort physique et la résistance à la peine.Aujourd’hui, le travail est aussi une source d’épanouissement et de sens. Les nouvelles générations (Millennials, Gen Z) recherchent un équilibre, une utilité sociale, et refusent le sacrifice systématique de leur bien-être.
Il faut également prendre en compte la montée de l’individualisme et en comprendre les conséquences. Aujourd’hui l’individu lambda « individualiste » devient mécaniquement responsable de son bonheur et de sa santé, sans forcément être prêt à cela et en avoir compris toutes les conséquences. L’exemple est caricatural, mais il m’amuse (tristement…) toujours beaucoup quand je vois le ou la jeune qui veut être un top influenceur à Dubaï pour être facilement riche, baigner dans le « bien-être » d’un pays où le désert n’est pas que de sable, et qui s’aperçoit qu’il faut travailler … On peut alors comprendre la schizophrénie de certains qui veulent leur bonheur sans y arriver et qui finissent par afficher et crier régulièrement « mais que fait l’État » !
Mais attention, ce ne sont pas les nouvelles générations qui ont changé. Là où le problème existe, heureusement ce n’est pas partout, il faut comprendre et admettre que le travail et son environnement ont changé. S’il est normal que les DRH se posent un certain nombre de questions sur les meilleurs moyens d’embarquer les nouvelles générations (rien de nouveau sous le soleil…), les vraies questions pour un dirigeant qui souhaite prendre en compte le sujet de la santé mentale, sont à aller chercher du côté de l’organisation des tâches et leur dé-taylorisation. Une partie des réponses passera par la reconstruction d’un collectif (les valeurs), pour ensuite recréer de la responsabilisation ce qui permettra de redonner du sens au management.
L’individualisme d’aujourd’hui crée chez beaucoup une pression supplémentaire du type « il faut réussir ET être heureux ». Comme dit le proverbe : « Seul, on va vite, mais ensemble on va plus loin ». Je ne suis pas loin de penser depuis quelques années, et je le pense tous les jours un peu plus, que l’entreprise est l’un des derniers lieux de socialisation. Apporter, créer, cette socialisation est l’une des meilleures armes de l’entrepreneur pour que son équipe soit performante. D’ailleurs dans cette logique d’entrepreneur qui cherche à apporter ce type de réponse, Elon Musk que je ne porte pourtant pas dans mon cœur, ne vient-il pas de créer la « ville idéale »[1] pour loger son personnel et réinventer la collectivité ? … Le paternalisme Michelin ou Boussac et les corons sont de retour ! Drôle de paradoxe chez l’Oncle Sam, ultra libéral, ultra individualiste et de plus en plus libertaire.
La nature de la souffrance au travail a changé, la tolérance à la souffrance a diminué, tandis que les exigences de qualité de vie ont augmenté, c’est le paradoxe d’un monde moderne que l’on nous prédisait plus confortable…
Les chiffres
Le sujet de la santé mentale est donc admis, et comme il est reconnu, magie de nos sociétés modernes, il est mesuré et les chiffres font peur :
- 34 % des salariés français en burn-out ou à risque – Baromètre Empreinte Humaine Opinion Way, sept. 2024
- 7 % des cas (soit ~30 000 personnes) en épuisement professionnel sévère – Institut de veille sanitaire, 2024
- Les secteurs les plus touchés par le burn-out : santé (60 % des médecins, 50 % des infirmiers), éducation, social, cadres supérieurs – Observatoire MNH, 2024
- 40 % des salariés ressentent une souffrance liée au travail (burn-out ou bore-out). Étude Ignition Program/Carenews, 2024.
- 43 % des moins de 35 ans et 45 % des managers en burn-out (2024). Étude Indeed, 2024.
- 61 % des actifs stressés au moins une fois par semaine (19 % quotidiennement). Enquête People At Work, 2024.
- Le burn-out coûte plusieurs milliards d’euros par an (absentéisme, turnover, baisse de productivité). Rapports ANACT/INRS.
- 81 % des responsables RH déclarent se sentir épuisés (2024), et 84 % ressentent fréquemment du stress – Sage, 2024.
- Les femmes sont plus touchées 23 % vs 15 % des hommes.
- Les managers sont surreprésentés parmi les cas de burn-out (45 %).
On pourra toujours débattre pour savoir quelle est la part de ces chiffres qui est de la responsabilité du travail et donc de l’employeur, quelle est la part liée à la vie privée et quelle est la part provoquée par le monde en désordre dans lequel nous vivons. Mais peu importe, les managers et les dirigeants doivent faire avec cette matière.
Nous avons vu au travers les chapitres précédents comment la prise de conscience sur le sujet de la santé mentale est arrivée ; nous avons synthétisé ce que la science nous apprenait ; nous venons de mieux comprendre pourquoi et comment ce sujet était né ; il nous reste à voir dans le prochain et dernier chapitre les différentes actions possibles pour prévenir et agir face à ce problème.
Conclusion
Je la laisse à Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des hommes : « La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines ». Dans cette période où les repères historiques sont remis en cause et les liens entre les hommes tellement perturbés, soignons au sein de nos entreprises l’un des derniers environnements collectifs qui résistent au chaos.
Michel MATHIEU
Le 17 octobre 2025
Après avoir vu dans le premier article, comment de grands champions ont su briser le silence qui existait sur ce sujet de la santé mentale, nous avons fait une synthèse dans le deuxième sur ce que nous dit la science de cet enjeu. Nous verrons dans le suivant comment agir au sein de l’entreprise pour prévenir ce mal nouveau ; enfin, dans le dernier article, nous verrons comment survivre et se protéger contre le tsunami de l’information et en particulier, la tyrannie des emails.
[1] Pour ceux qui n’ont pas entendu parler du projet, demandez à votre IA de vous expliquer « Starbase à Boca Chica au Texas » ou, voir en annexe de la version intégrale de cet article.