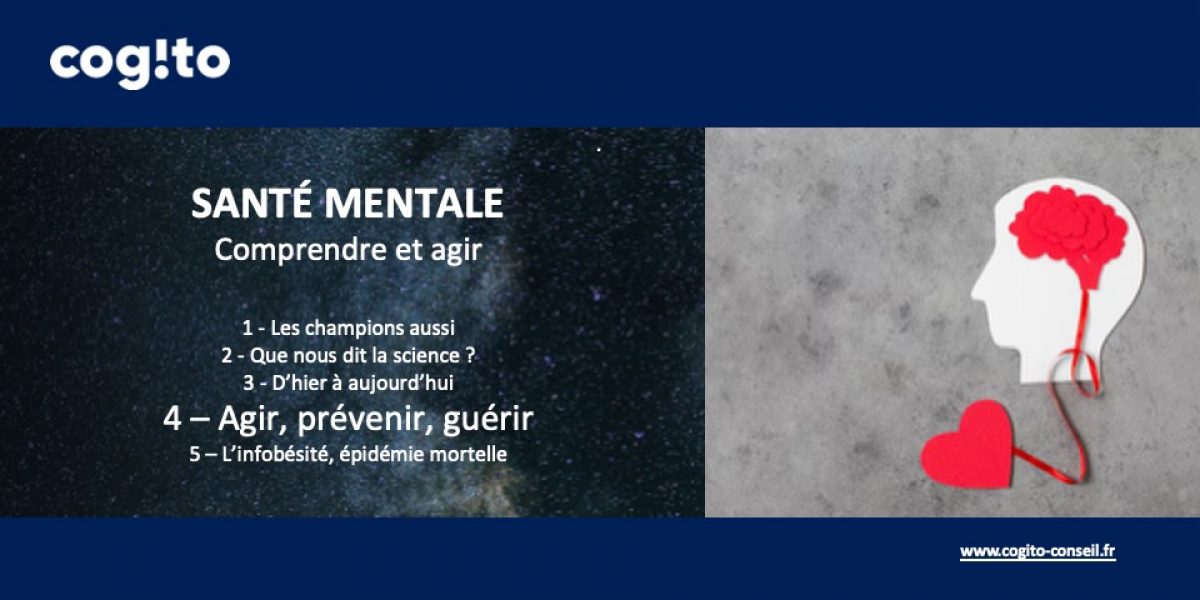À l’issue d’une séance de travail, une très bonne DRH que je respecte pour son professionnalisme et son implication insistait : « La santé mentale n’est pas un problème de plus, mais une chance de repenser le travail ». Elle a à la fois tort et raison. Tort, parce que pour un dirigeant ou un top manager, c’est bien un problème de plus qui s’ajoute à sa longue liste de sujets, préoccupations, priorités, enjeux, choix, inquiétudes, décisions et autres réflexions qui font son quotidien. Mais elle a aussi raison, c’est l’occasion de se reposer quelques bonnes questions sur le travail. Je propose trois axes différents de réflexion :
- L’organisation stratégique de l’entreprise.
- La relation du manager au managé.
- La relation que l’on a à soi-même.
L’organisation stratégique de l’entreprise.
« La santé mentale n’est pas un signe de faiblesse, mais la base de toute performance » nous dit Michael Phelps. Je corrigerai un peu, ce n’est pas la base de toute performance, c’est l’un des éléments de création de la performance qu’il faut prendre en compte ; pour moi, cela passe par un travail sur l’organisation stratégique de l’entreprise.
« L’organisation stratégique suit la stratégie comme le pied gauche suit le pied droit » dit Henry Mintzberg[1]. Le concept d’organisation stratégique désigne la manière dont une entreprise, ou une institution, structure ses ressources, ses processus et ses compétences pour atteindre ses objectifs à long terme. L’organisation stratégique vise à aligner les éléments suivants :
- Un système de valeur clair, partagé, appliqué.
- Une raison d’être.
- Une stratégie : croissance, rentabilité, expertise, innovation, produit, …
- Une gouvernance et une organisation : qui fait quoi ? Quand ? Comment?
- Un système de management stratégique : tableaux de bord, objectifs, reconnaissance, responsabilisation des managers, …
Si le système est bien construit, il va générer une énergie endogène positive qui représente une économie d’énergie pour le management ; elle permettra aux dirigeants et principaux cadres de mieux se concentrer sur leur cœur de métier : le développement de l’entreprise. Malheureusement, dans la vraie vie, tous ces points sont rarement, et simultanément, alignés ou parfaitement en place. En cas de problème identifié (perte de performance, délai allongé, perte de qualité, baisse de la productivité, turn-over, etc), il s’agira de comprendre à quel niveau se trouve le dysfonctionnement qui provoque le mauvais stress de l’organisation et de voir si cela a pu générer des problèmes de santé mentale chez certains collaborateurs.
Si l’entreprise, son dirigeant, sa gouvernance, la direction des ressources humaines, ne sont pas en mesure de mener le diagnostic, des conseils externes peuvent être sollicités. C’est à ce niveau que peut intervenir l’outil MBI de Christina Maslash (voir §2). Il permet d’évaluer le niveau de burn-out au sein de l’entreprise, d’identifier les risques et de suivre l’efficacité des actions de prévention ou d’accompagnement. Au travers 22 questions, où les réponses sont notées sur une échelle de 0 (« jamais ») à 6 (« tous les jours »), le questionnaire va évaluer, auprès d’un groupe d’individus, la fréquence de sentiments ou de comportements liés au travail sur trois dimensions :
- L’épuisement émotionnel : le sentiment d’être vidé de ses ressources émotionnelles, de ne plus pouvoir donner de soi au travail.
- La dépersonnalisation ou déshumanisation : l’attitude de détachement, de cynisme ou d’indifférence envers les collègues ou les clients.
- La réduction de l’accomplissement personnel : le sentiment de ne plus être compétent, de ne plus réussir dans son travail, accompagné d’une baisse de la motivation et de la satisfaction professionnelle.
Chacune de ces dimensions sera analysée séparément et apportera des enseignements différents. Un score élevé en épuisement émotionnel et en dépersonnalisation, associé à un score faible en accomplissement personnel, indiquera un risque élevé de burn-out. Le MBI est un outil fiable et largement validé pour repérer les signes de burn-out, mais il doit être interprété par un professionnel formé, idéalement dans le cadre d’un accompagnement global. Son utilisation peut être soumise à des droits d’auteur.
Au sein de l’organisation de l’entreprise, le pilotage des actions appartient naturellement à la direction des ressources humaines. À elle de partager au plus grand nombre, sensibilisation, outils et méthodes à disposition. La mise en place d’un plan de prévention des risques psychosociaux est une obligation, mais passer par la logique « d’obligation » est à mes yeux contre-productif. Il faut intégrer ce plan comme une conséquence de la réflexion de l’entreprise pour se créer un maximum de conditions favorables à sa performance. La santé mentale devient alors un levier au service des avantages compétitifs.
Du manager au managé.
Pour les managers qui ne sont pas tous dirigeants, ils doivent par eux-mêmes, ou, si elle existe, par intégration à la dynamique de leur entreprise, connaitre les essentiels sur le sujet. Pour tout manager, que ce soit pour lui ou pour ses collaborateurs, il est utile d’avoir en tête l’outil de H. Freudenberger (voir §2) qui identifie 12 étapes dans la construction d’un burn-out :
1 – Besoin de se prouver :
La personne ressent le besoin de prouver sa valeur, souvent en travaillant excessivement.
2 – S’investir davantage
Elle augmente son investissement au travail, au détriment d’autres aspects de sa vie.
3 – Négliger ses besoins
Les besoins personnels (sommeil, alimentation, loisirs) sont ignorés ou minimisés.
4. Refoulement des conflits
Les problèmes ou conflits sont niés ou repoussés, plutôt que résolus.
5. Réinterprétation des valeurs
Les valeurs personnelles (famille, amis, santé) sont reléguées au second plan, au profit du travail.
6. Déni des problèmes
La personne nie l’évidence de son mal-être, attribuant son stress à des causes externes.
7. Repli sur soi
Elle s’isole, évite les interactions sociales et devient cynique ou irritable.
8. Changements de comportement
Comportements inhabituels (impatience, agressivité, consommation accrue de café, alcool, etc.).
9. Dépersonnalisation
Perte de contact avec soi-même et les autres ; sentiment de détachement ou de déshumanisation.
10. Vide intérieur
Sensation de vide, d’absence de sens, parfois accompagnée d’anxiété ou de dépression.
11. Dépression
État dépressif marqué, avec perte d’espoir et sentiment d’échec.
12. Épuisement total
Effondrement physique et mental, nécessitant souvent un arrêt complet.
Ces étapes ne sont pas linéaires pour tout le monde, mais elles illustrent une progression typique vers le burn-out. Freudenberger insistait sur l’importance de reconnaître ces signes précocement pour prévenir l’épuisement. Le manger, sensibilisé aux signes de la progression insidieuse du mal, pourra agir plus tôt et donc réduire les dommages chez les collaborateurs et dans l’organisation.
La relation que l’on a à soi-même
Normalement, un dirigeant ou un top manager n’est pas à ce niveau de responsabilités sans avoir un parcours qui lui a déjà apporté un nombre important d’enseignements sur lui-même. Il se connait, il a conscience de ses limites, il connaît les signaux l’avertissant qu’il n’est pas loin d’entrer en « zone rouge » (fatigue chronique, mauvais sommeil, déséquilibre vie privée / vie perso, etc…). Si cette conscience est là, la question est de savoir à qui parler ?
J’ai eu à me poser cette question dans une phase très intense où j’avais clairement identifié que je me rapprochais de la « zone rouge ». C’était le moment de la crise financière de 2008 – 2010, celle dite de Lehman Brothers. Mon choix a été d’en parler à mon médecin généraliste, médecin, détail très important, qui me connaissait depuis longtemps. Je pense que c’est la meilleure solution. Il a mis des mots sur cette fatigue : « Danger de burn-out ». Il a su me proposer la solution qui me convenait : ce fut trois mois d’accompagnement par une sophrologue. À partir de là, j’ai su, j’ai pu, prendre quelques décisions : allègement de l’agenda, en particulier par réduction des déplacements, puis par arbitrage sur certains sujets « urgents » qui pouvaient dans le contexte être décalés dans le temps sans véritable conséquence ; discipline et rigueur pour supprimer le travail « à la maison » qui s’étaient progressivement imposé le samedi matin ; réduction, non pas du sport (course à pied), mais de son intensité. Ainsi, en trois mois, bien accompagné, ces actions ont permis de faire redescendre progressivement le taux d’adrénaline (voir chapitre précédent), de rééquilibrer la physiologie et de revenir à un niveau d’activité normale sans utiliser les solutions toxiques (médicament, alcool, drogue, …) qui ne font que masquer, provisoirement, le problème.
C’est à chacun de trouver à qui en parler et d’adapter les solutions qui lui conviennent le mieux. De façon générale, on peut retenir plusieurs stratégies permettant de réduire ou de mieux gérer le stress :
- Pratiquer une technique de relaxation : respiration profonde, méditation, yoga, sophrologie.
- Intégrer de l’activité physique pour ceux qui n’en font pas : le sport libère des endorphines, hormones du bien-être.
- Réduire l’intensité de l’activité physique pour ceux qui en font trop ; ou changer d’activité physique si celle pratiquée est plutôt génératrice d’un surplus d’adrénaline (type squash, boxe, MMA, …) alors qu’il faudrait plutôt en réduire la production.
- Soigner son alimentation : limiter caféine, sucre et alcool ; privilégier les aliments riches en magnésium et oméga-3.
- Prioriser son sommeil.
Conclusion
La santé mentale est devenue un sujet de responsabilité sociale et juridique, pas seulement un problème individuel. Évidemment, tout le monde n’est pas concerné par le problème de santé mentale, mais le fait que le phénomène concerne de plus en plus de personnes nécessite que le sujet soit traité dans les grands, et déjà nombreux, enjeux de l’entreprise.
L’entreprise, dans sa guerre concurrentielle permanente, doit intégrer le sujet à sa stratégie pour trois raisons essentielles :
- L’enjeu de performance : le burn-out et le bore-out réduisent la productivité et augmentent le turnover.
- La responsabilité légale : depuis 2021, les employeurs ont l’obligation de prévenir les risques psychosociaux.
- La concurrence : une politique proactive en santé mentale améliore l’attractivité et l’engagement des talents et, de meilleurs talents font une meilleure entreprise.
Hier, gérer la santé mentale relevait de l’intime ou du médical. Aujourd’hui, le sujet s’est invité, pour ne pas dire s’est imposé, dans le management de l’entreprise. En synthèse, les grands réflexes à avoir et à partager au sein des organisations sont :
- Dépister les nouveaux risques : sur-sollicitation numérique, isolement, manque de reconnaissance (vs risques physiques d’autrefois).
- Identifier les profils à risque.
- Se former à repérer les signes de souffrance mentale (désengagement, irritabilité, présentisme).
- Se former à la reconnaissance.
- Créer des espaces de parole et mettre en place des « référents santé mentale » afin de normaliser les discussions sur le stress et l’épuisement.
- Observer en permanence le fonctionnement de l’organisation pour agir avant que les problèmes n’apparaissent.
- Au quotidien, limiter les réunions inutiles, encourager les pauses, clarifier les priorités pour réduire l’anxiété liée à la charge mentale.
Michel MATHIEU
Le 17 octobre 2025
Après avoir vu dans le premier article, comment de grands champions ont su briser le silence qui existait sur ce sujet de la santé mentale, nous avons fait une synthèse dans le deuxième sur ce que nous dit la science de cet enjeu. Dans le troisième, nous avons expliqué pourquoi ce problème qui n’existait pas il y 100 ou 150 ans est aujourd’hui aussi prégnant. Nous verrons dans le dernier article de cette série, comment survivre et se protéger contre le tsunami de l’information et en particulier, la tyrannie des emails.
[1] Référence majeure de la pensée stratégique et des organisations des 30 dernières années.